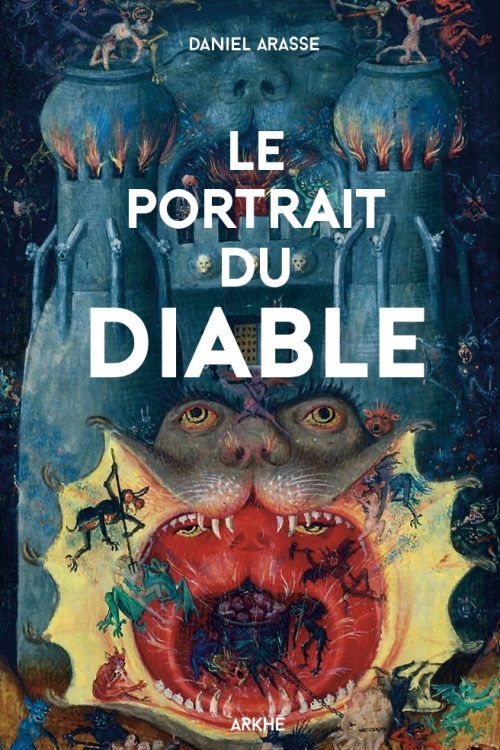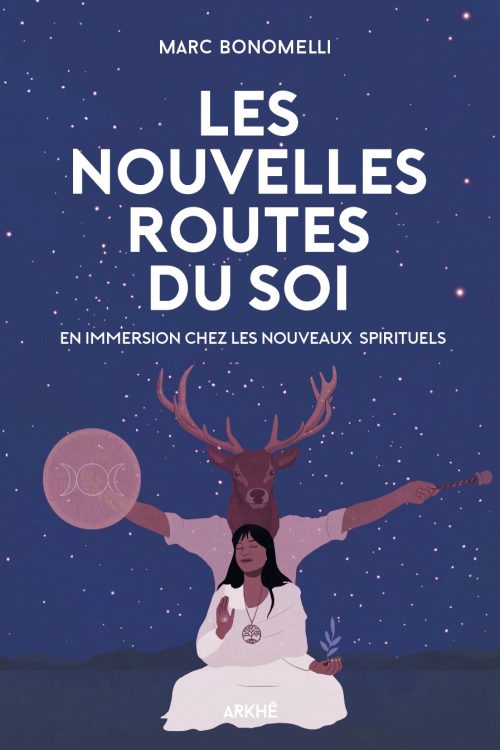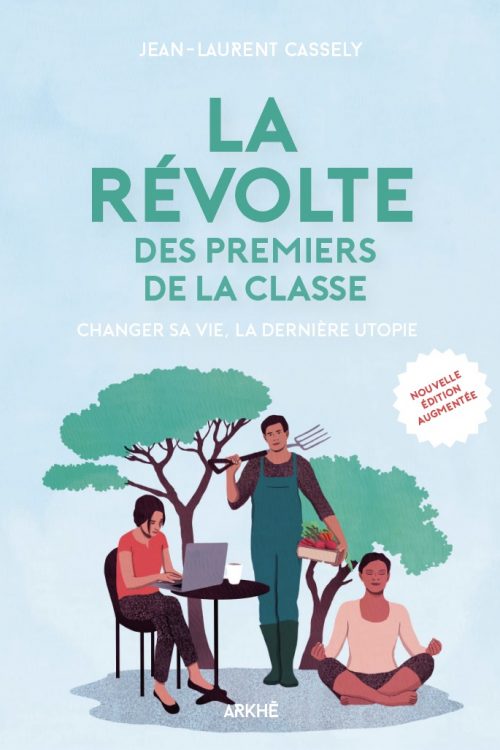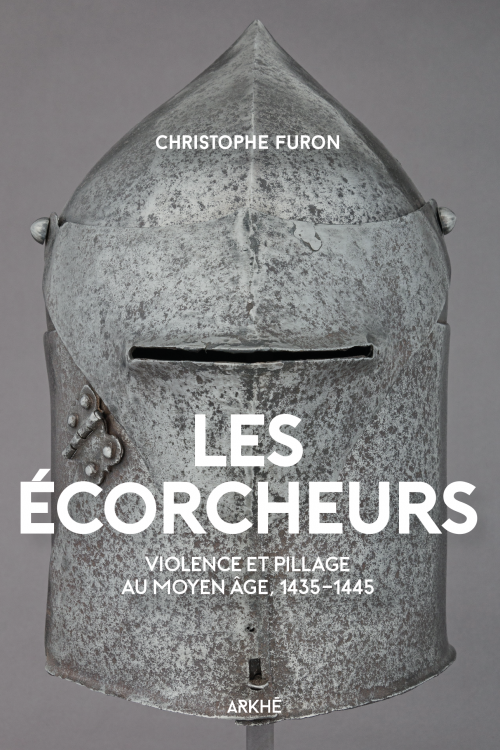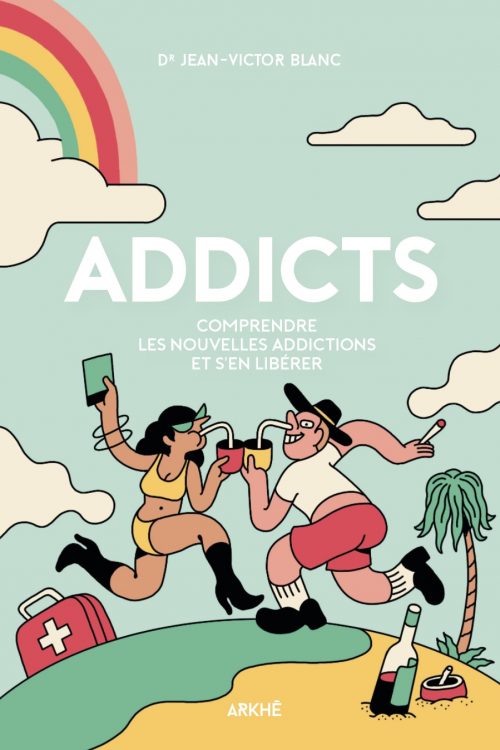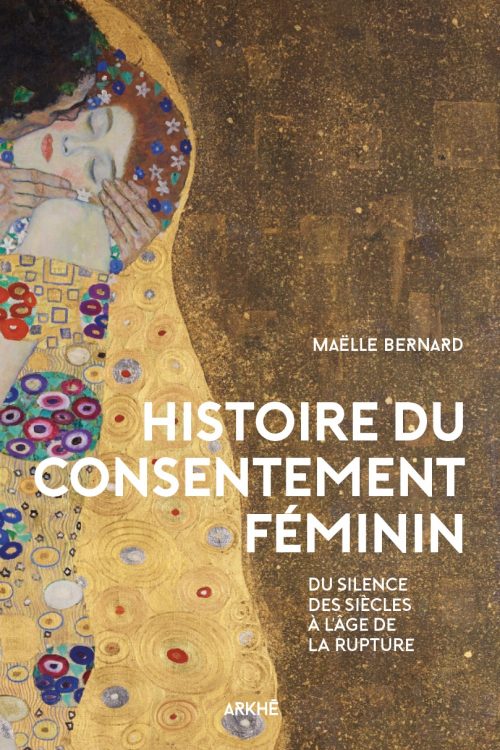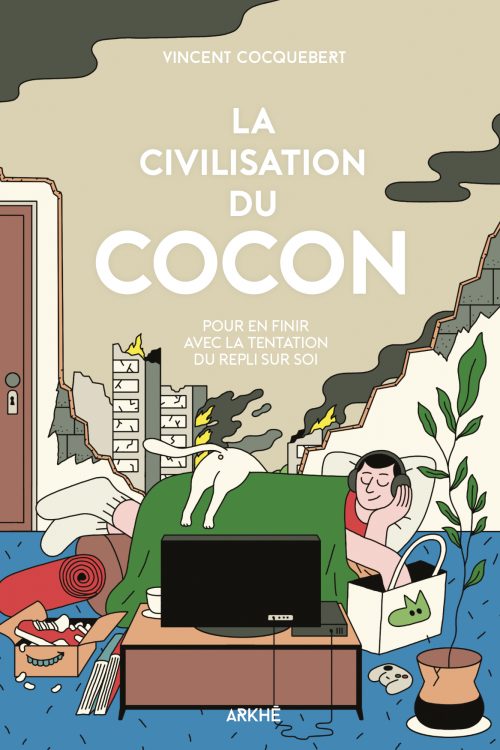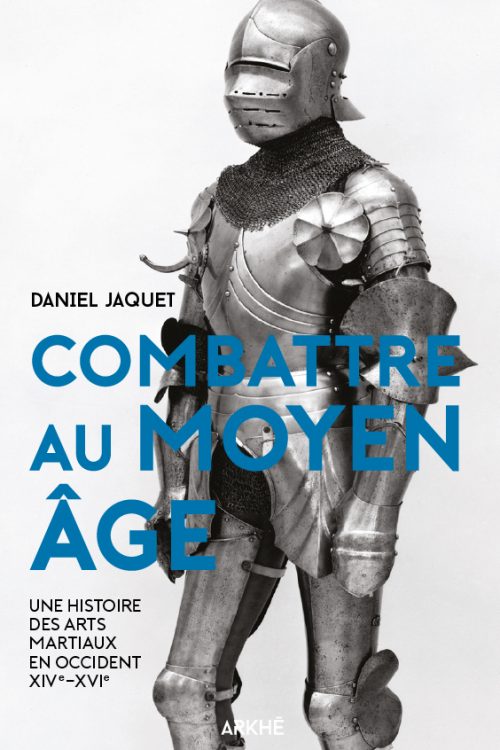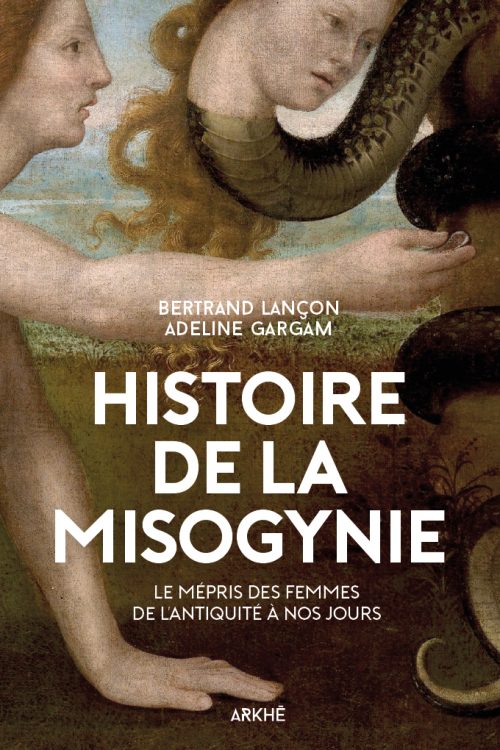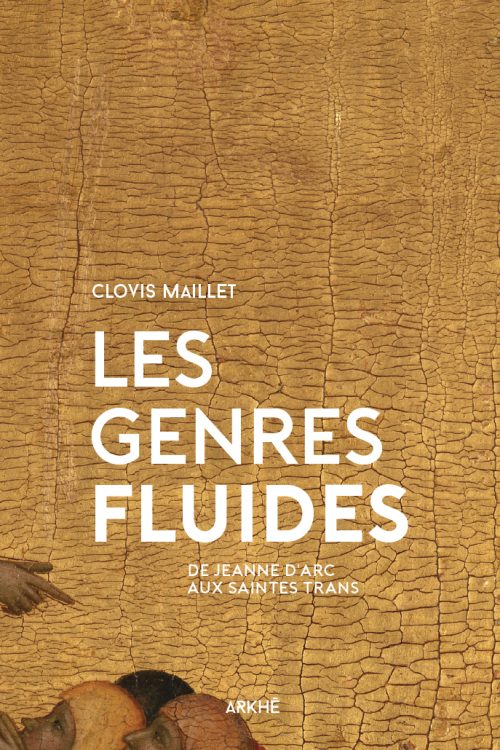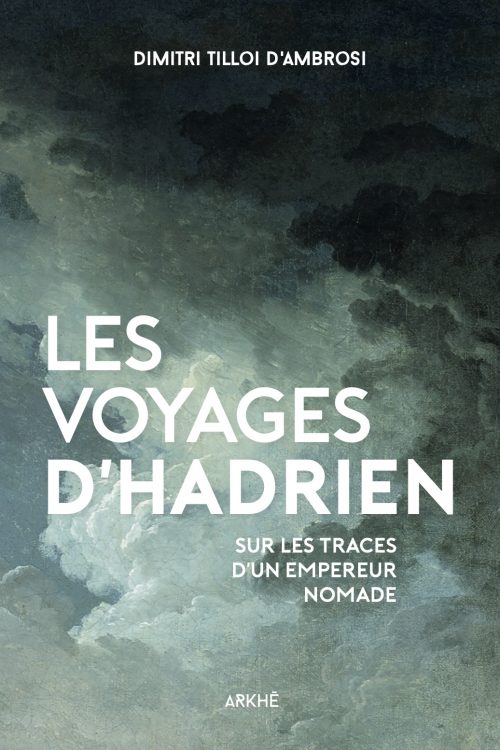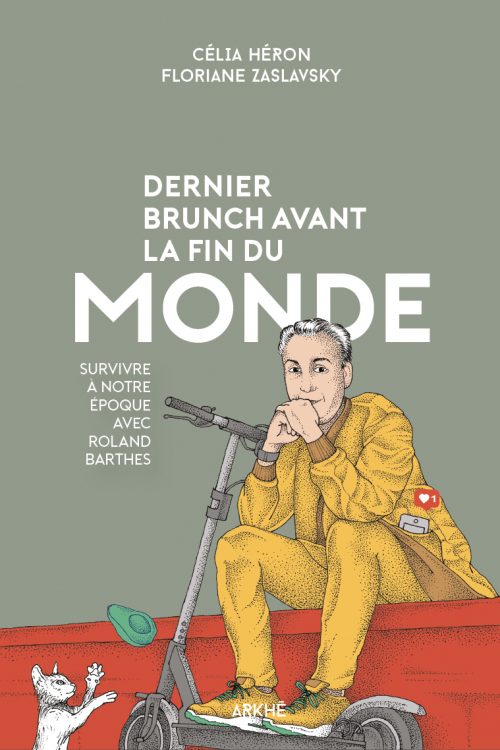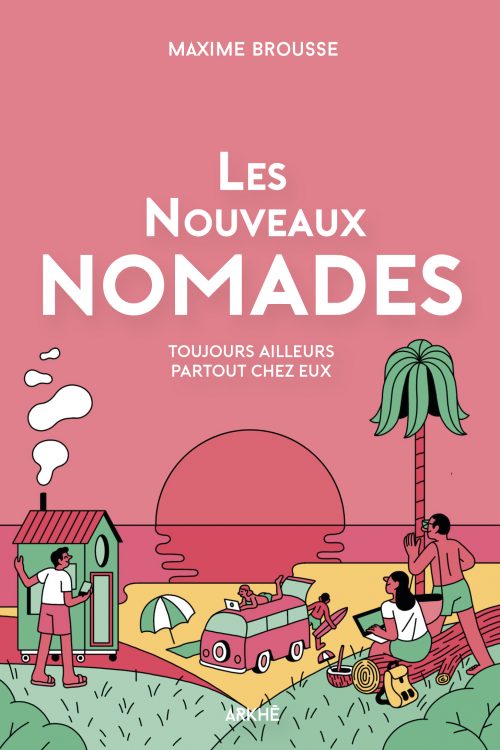La Tech ne s’attaque pas simplement à notre flemme mais à notre besoin d’appartenance et de reconnaissance
Leur « newsletter bête et méchante » réjouit chaque semaine tous ceux (très nombreux) qui n’en peuvent plus de la novlangue made in Silicon Valley et du mythe de la start-up Nation. Tech Trash débarque en librairie avec un premier ouvrage, Les Possédés, dans lequel il tire à boulets rouges sur le monde fantastiquement allumé de la Tech. Avec l’esprit potache et le ton grinçant qui ont fait son succès, le collectif remonte aux origines de la flamboyante légende des GAFA pour mieux la tourner en ridicule. Rencontre avec deux représentants du collectif et co-auteurs du livre, Lauren Boudard et Dan Geiselhart.
D’où est partie l’idée de fonder le collectif Tech Trash ?
Il y a encore assez peu de temps, l’humeur générale dans le monde de la Tech, c’était d’encenser tout et n’importe quoi, du moment que ça avait un rapport de près ou de loin avec quelque chose de vaguement innovant ou de « connecté ». Au niveau des médias, c’était peu ou prou la même chose : à part quelques exceptions, tous les sites, magazines ou newsletters délivraient alors le même baratin (trop) souvent rempli de projets inutiles ou carrément absurdes. Nous sommes un petit groupe de personnes travaillant de près ou de loin dans le milieu de la tech et des start-up, et on avait tous cette frustration de ne pas pouvoir lire de média français sur le sujet à la fois drôle, pertinent et critique. On s’est dit que ce serait amusant de pouvoir se moquer des codes inhérents à cet univers, à ses travers risibles, comme ce verbiage anglo-saxon directement transposé en français, bourré de déclarations grotesques… Ça a donné notre auto-proclamée « newsletter bête et méchante », quelques articles sur notre site et aujourd’hui ce premier ouvrage.
Dans votre ouvrage, vous convoquez un monde merveilleux, fait de princes charmants aux pouvoirs extraordinaires et de licornes magiques… Pourquoi ce choix du vocabulaire quasi mythologique ?
Avec le livre, l’idée était de prendre un peu de recul sur le déluge d’actualités tech et de revenir aux sources de la mythologie : comprendre comment ces empires ont été construits, comment ces réussites ont été provoquées. Force est de constater qu’une majorité d’entre-elles ne repose pas, comme on l’entend partout, sur le génie des ingénieurs qui auraient inventé ex nihilo des innovations technologiques incroyables, mais plutôt sur un storytelling redoutable. Prenons l’exemple de WeWork : cette entreprise a simplement « rebrandé » le fait de louer des espaces de co-working, rien de plus. Elle y a ajouté le fait d’avoir du café gratuit et des bureaux un peu design, tout ça pour 350 euros par mois minimum. Airbnb n’a pas fait beaucoup mieux : la plateforme a conceptualisé le fait de louer son appartement et a réussi à nous faire croire que, grâce à ça, nous pourrions reprendre « confiance » en notre prochain.
Avec le livre, l’idée était de revenir aux sources de la mythologie
Si l’on prend un peu de recul, on voit que les géants de la tech ont suivi la même voie que les mastodontes des années 1980 et 1990 : elles ont réussi à créer une émotion autour de leur marque dépassant de loin leur activité principale, qui est de vendre des outils technologiques. Google ou Apple représentent quelque chose en tant que tel pour le commun des mortel, et c’est bien plus qu’un simple moteur de recherche, ou qu’une entreprise qui fabrique du hardware. Comme Coca-Cola, Nike ou McDonald’s dans les années 1990, les géants du numérique sont devenus ce que Naomi Klein appelle des « brandosaures », on pourrait même parler ici de « tech-brandosaures ».
Vous expliquez que ce storytelling est accompagné d’une véritable philosophie qui se diffuse dans nos modes de vie…
C’est le deuxième point : la force de la tech est de disposer d’un soft power incroyablement puissant, comparable à un culte, qui a permis à ces entreprises de modifier en profondeur nos façons de nous représenter le monde dans lequel nous vivons. Cela passe par nos façons d’organiser nos vies, nos représentations du monde, notre socle éthique : ce que nous considérons comme beau, comme bien, comme agréable. La valeur travail, et même ce que nous nommons « l’hyper-travail », nous vient d’eux également. Il y a des cas particulièrement ahurissants, comme celui de Marissa Meyer, ancienne CEO de Yahoo, qui se vantait de travailler 100 heures par semaine !

Plus largement, la tech valorise le dépassement de soi-même, comme s’il était possible de repousser sans cesse les limites que notre corps nous a fixées. Sans oublier le fait de surveiller tous nos faits et gestes, d’explorer le moindre recoin de notre intimité : cycle menstruel, sommeil, plus rien n’y échappe… Dans les années 1990, un certain Gordon Bell, ingénieur chez Microsoft, a fait la même chose et a appelé ça le « life logging ». À l’époque, tout le monde l’a pris pour un fou. Aujourd’hui, ça ne choquerait plus personne…
L’idée de techlash transparaît tout au long du livre : le techlash, c’est quoi ?
C’est un terme utilisé pour la première fois par The Economist en 2017 suite à l’affaire Cambridge Analytica. Pour faire simple, le techlash, c’est la fin de la naïveté, la prise de conscience généralisée que tout n’est pas si rose dans le monde merveilleux de la tech. Une « entaille dans nos certitudes » comme on le définit dans le livre. Aujourd’hui, on observe un alignement entre l’opinion politique, publique, la presse et les employés du secteur, c’est un véritable tournant. En 2019, plus personne n’oserait parler de la livraison « chic et branchée » de Deliveroo comme le faisait le Figaro au début des années 2010.
Cet empire magique est en grande partie basé sur de la poudre de perlinpinpin, voire carrément du mytho
Qui plus est, les scandales, notamment financiers, se succèdent et démontent le mythe de la ruée vers l’or. On commence progressivement à comprendre que cet empire magique est en grande partie basé sur de l’esbroufe, sur de la poudre de perlinpinpin, voire carrément du mytho. Et quand le storytelling s’invite jusque dans les comptes de résultats des entreprises, ça ne donne en général rien de glorieux. Chez WeWork, on parle de « community adjusted earnings » et non pas de bénéfices pour endormir la galerie. Du côté d’Uber, on préfère parler de « marché total adressable » tournant autour de 12 mille milliards de dollars (!), plutôt que de rentabilité. 12 mille milliards, c’est 15 % de toute la valeur économique mondiale, c’est 4 fois le PIB français, à ce stade on est carrément dans le mensonge !
Vous évoquez un paradoxe intéressant : pourquoi, malgré les scandales et ce techlash ambiant, continuons-nous de scroller sur Instagram à l’arrière d’un Uber ?
En effet, c’est la question sur laquelle nous nous sommes penchés : en tant qu’utilisateurs et « experts » de ces outils, on est fascinés par cette dissonance cognitive entre nos choix et nos valeurs, qui s’exprime quotidiennement, et que les philosophes grecs appelaient « akrasia » ou acrasie, cette propension à voir le bien et faire le mal. Concrètement, nous sommes bien conscients que la gestion algorithmique du travail des plateformes telles qu’Uber ou Deliveroo est inhumaine. En Espagne, Glovo a indemnisé l’équivalent de 20 000 euros la famille d’un livreur décédé alors qu’il était en train de livrer des burgers. En France, le livreur UberEATS Frank Page est décédé en janvier après avoir été percuté par un poids lourd, tandis que Mourad, un livreur Deliveroo de 24 ans, est paralysé à vie suite à un accident survenu cet été à Mulhouse. Ces accidents sont directement corrélés au modèle économique des plateformes.
La tyrannie de la commodité est plus forte que toutes les informations sordides
Pourtant, ce qui est stupéfiant, c’est que nous sommes comme anesthésiés, que la tyrannie de la commodité est plus forte que ces informations sordides. Pourquoi continue-t-on de se faire livrer nos burgers sur ces applis ? Pourquoi un boycott général ne s’organise pas ? Plus largement, comment se fait-il que ces entreprises se soient immiscées dans nos vies jusqu’à en devenir indéboulonnables ? Tout ça alors que nous savons qu’elles font parfois (souvent ?) n’importe quoi avec nos données personnelles, qu’elles s’extraient délibérément du régime fiscal auxquelles elles sont soumises via des pratiques quasi-mafieuses, tandis que que nous restons là à courir derrière leurs services et à cliquer sur « j’accepte » à la moindre occasion…
Pourquoi ne pas proposer de solutions face à cette quête effrénée ? Boycott, solutions alternatives : pourquoi toutes ces solutions ne vous semblent elles pas valables ?
On voit régulièrement passer des articles qui prônent la déconnexion, partielle ou totale, comme si c’était le nouveau Graal à atteindre. On en arrive même à certaines absurdités, avec des gens se mettant en scène sur les réseaux sociaux en train de quitter les réseaux sociaux. Selon nous, c’est prendre le problème par le mauvais bout : il est trop facile de faire peser la responsabilité sur l’utilisateur. Et s’il est en effet assez simple d’arrêter d’utiliser des services de livraison à la demande comme Deliveroo ou UberEATS, il est beaucoup plus compliqué de « quitter » des réseaux comme Facebook ou WhatsApp vu qu’on se coupe d’une partie (voire de l’intégralité ?) de nos relations. On ne s’attaque pas simplement à notre « flemme » mais à notre besoin d’appartenance, de reconnaissance.
On croit beaucoup au fait de comprendre et d’assimiler des choses via le rire, la satire
Une autre solution qui existe, c’est le fait de démanteler les GAFA, enlever du pouvoir à certaines entreprises devenues beaucoup trop puissantes, comme le prône, entre autres, la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren. L’auteur Scott Galloway explique par exemple qu’au lieu de « quatre grandes entreprises, il pourrait y en avoir 10, et nous aurions un écosystème plus riche pour stimuler à la fois la croissance de l’emploi et la valeur pour les actionnaires ». C’est un constat que nous partageons évidemment, même si, concrètement, si le modèle est pourri à la base, rien ne sert de créer dix petites entreprises pourries. On citera l’ami Edward Snowden : « ce qu’il faut changer, ce n’est pas une entreprise, un téléphone, un logiciel : c’est le système ».
Pourtant, nous sommes persuadés que la première étape passe par une prise de conscience collective. Et c’est là où se trouve notre rôle : on croit beaucoup au fait de comprendre et d’assimiler des choses via le rire, la satire. C’est une forme de catharsis. Si vous nous lisez et que ça vous fait marrer, c’est déjà un début de la réflexion. C’est notre forme de militantisme, sur le même modèle que peut le faire le Canard Enchaîné depuis plus d’un siècle, ou comme ont pu le faire, avec leur esprit potache mais néanmoins radical, certains comiques des années 1970, Coluche en tête.
Pour aller plus loin : Les Possédés (On vous recommande chaudement, du coup, l’achat sur la Fnac ou, encore mieux, ici !)
Pour vous abonner à la newsletter : Tech Trash