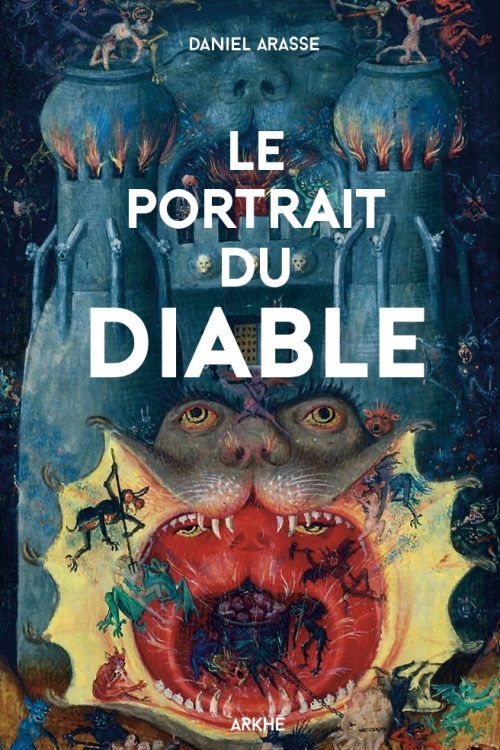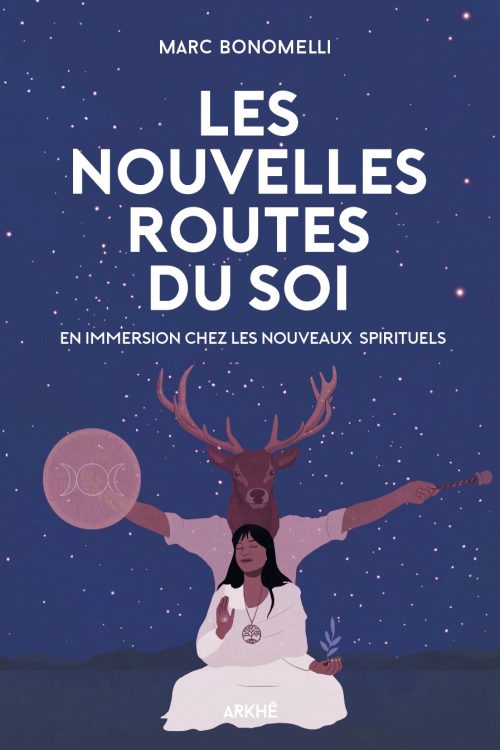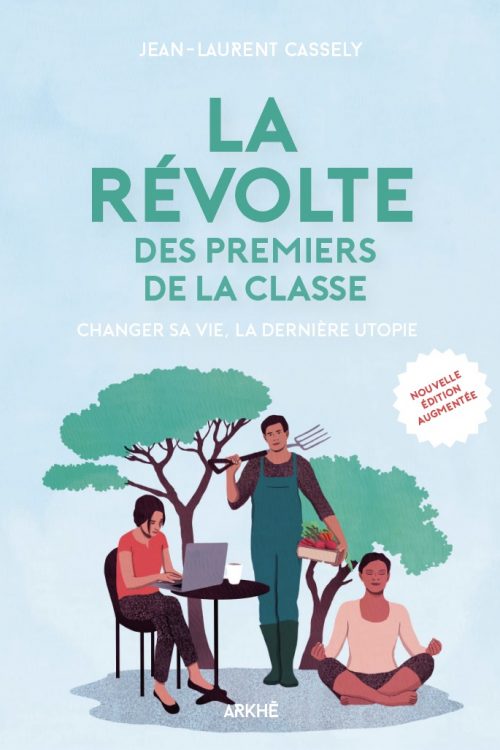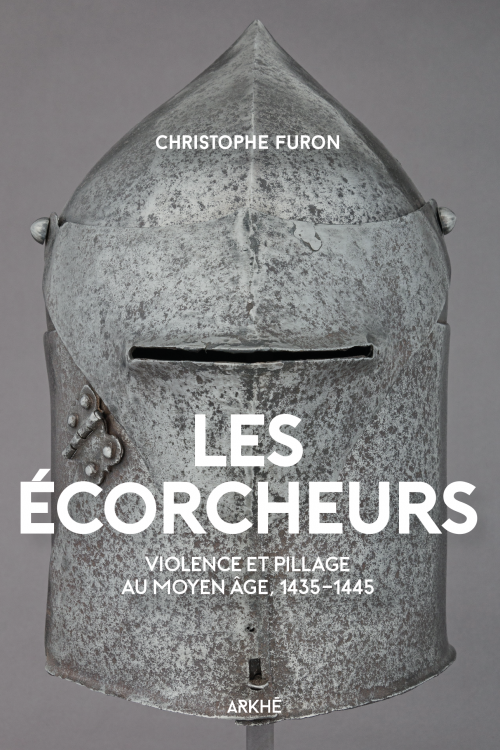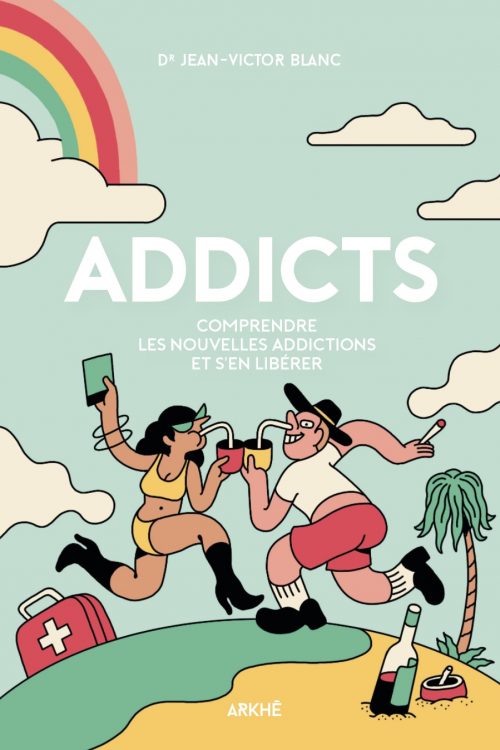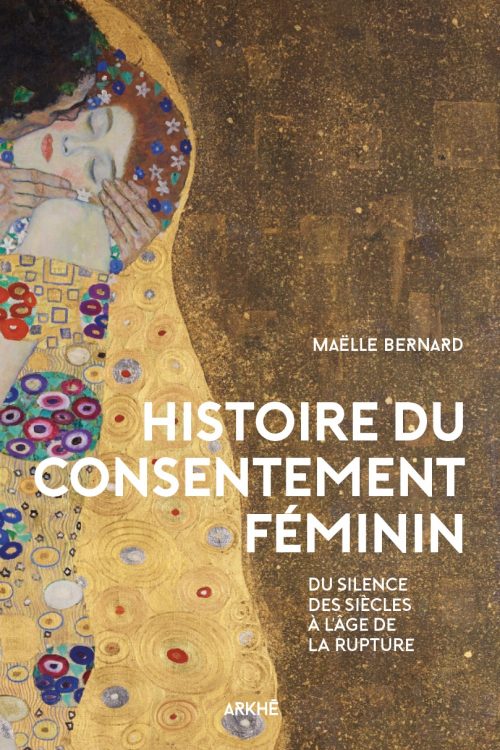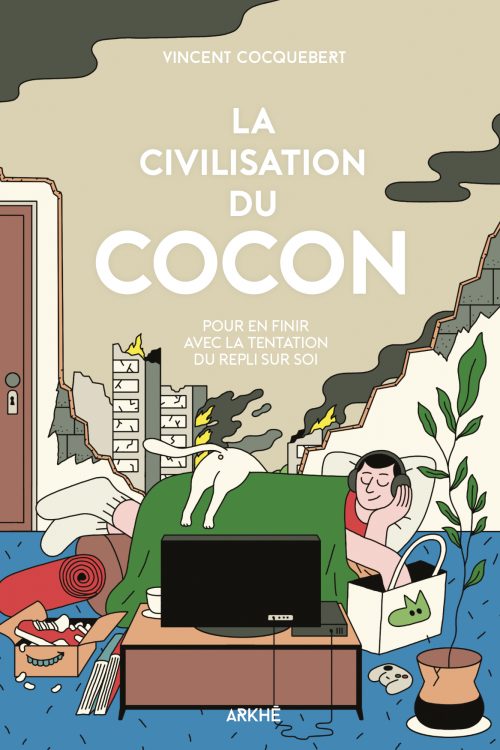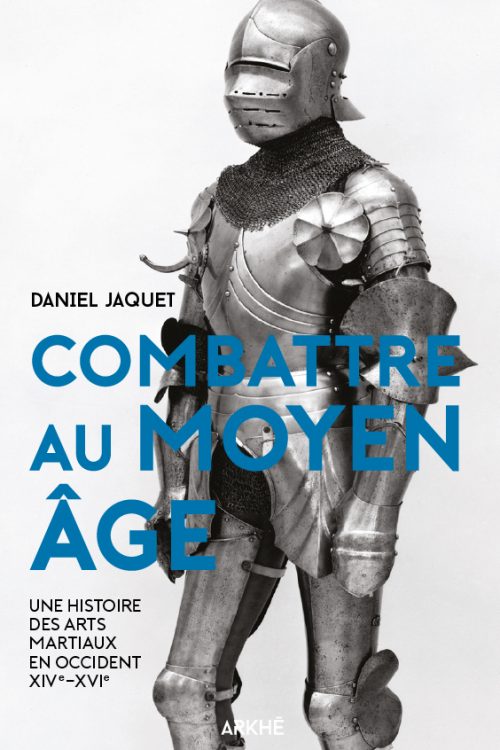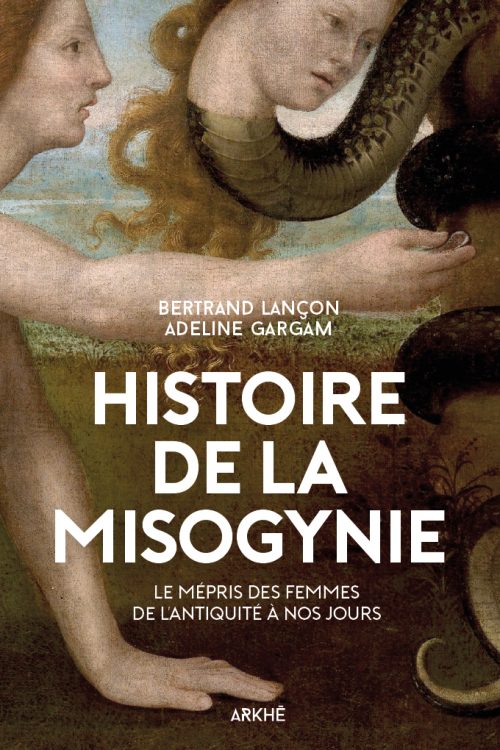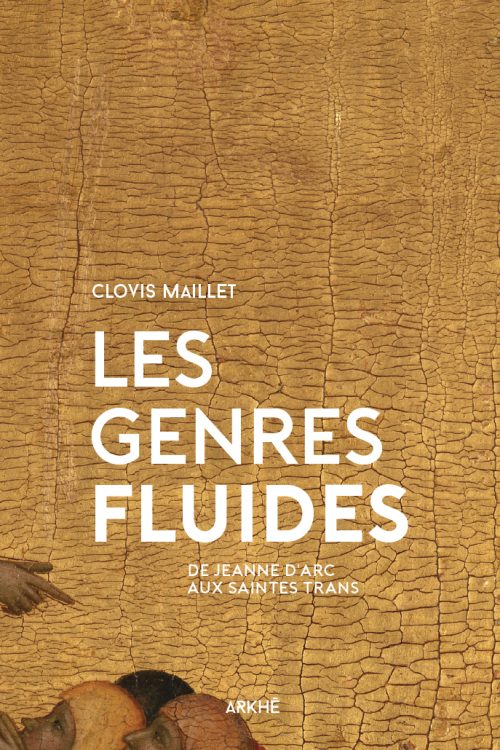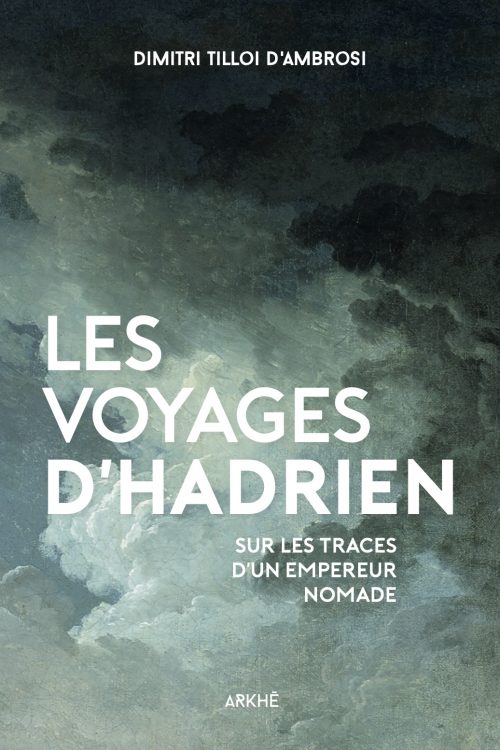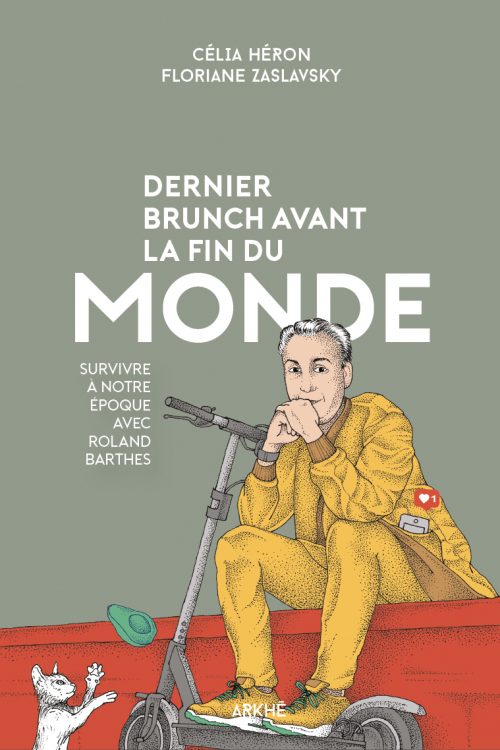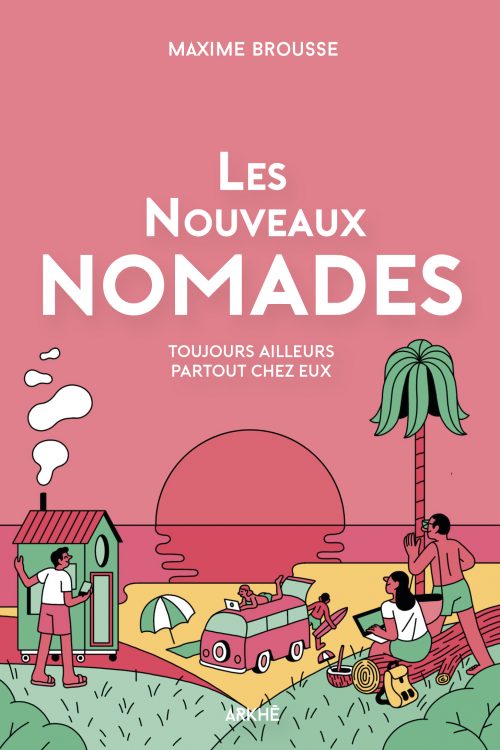Dans l’entre-deux-guerres, l’histoire en général et l’histoire globale en particulier expriment la faillite à penser la globalité hors des cadres nationaux : un avertissement important pour nos débats actuels.
Jeudi 24 novembre 2016, François Fillon annonçait l’urgence d’une réécriture de l’histoire : trop d’attention aurait été prêtée selon lui à l’histoire du monde, trop peu à celle de la France et ses valeurs. En septembre 2014, Vladimir Poutine avait annoncé le retour de l’histoire patriotique dans les manuels. Le 12 février 2017, Donald Trump twittait sur la nécessité d’apprendre aux enfants l’histoire des partis américains et recentrer l’enseignement sur l’Amérique.
Je pense à mes étudiants, des Français, des Russes et des Chinois, des Européens et des Africains, quelques Américains, deux Indiens, mais aussi des Brésiliens et une Japonaise. Faut-il que je leur apprenne l’histoire de France, celle de l’Europe, ou encore celle du monde ? Ce jeudi 24 novembre, ils me trouvent incertain. Je le suis. Je leur demande : « Si je vous dis histoire globale, vous pensez à quoi ? » Un Américain me lance : « histoire du monde », tandis qu’une jeune normalienne avance : « histoire connectée ». L’étudiante japonaise me regarde, intimidée, puis chuchote : « histoire de l’Europe. » Finalement, mon étudiant indien évoque l’histoire coloniale et l’impérialisme, tandis qu’un étudiant sénégalais conclut non sans irritation : « Professeur, l’histoire globale c’est encore une manipe du Nord pour contrôler le Sud ».
L’histoire globale est un peu tout ce qu’ils ont évoqué. Mais pourquoi est-elle si inquiétante pour Trump, Poutine ou Fillon, sans oublier Le Pen ?
Définir l’histoire globale
À première vue, la réponse est simple : l’histoire globale désigne des approches différentes qui ont toutes l’ambition de décloisonner les histoires nationales et les paradigmes européocentriques lisant l’histoire de la planète et de ses diversités à l’aune de quelques catégories et valeurs occidentales.
L’histoire globale inscrit celle de chaque pays dans des dynamiques plus larges dans lesquelles l’Occident n’est pas nécessairement synonyme de progrès. Cette manière de penser et de pratiquer l’histoire constitue une réponse aux phénomènes majeurs de notre époque depuis 1989 : la fin des « deux blocs », communiste et capitaliste ; la globalisation et ses effets ; enfin, de nos jours, le retour des nationalismes. Ces processus incitent trop souvent à envisager le processus historique comme un choc entre les civilisations.
Penser global exige un périple dans des mondes différents mais connectés, car l’histoire ne peut pas se limiter à l’histoire nationale : chaque pays, chaque clocher de France disait Braudel, se relie à d’autres pays, voire à d’autres mondes.
Pratiques historiennes et dynamiques historiques
Au XVIᵉ siècle, l’expansion vers l’Orient, puis vers les Amériques incite à globaliser l’histoire. L’émerveillement s’accompagne toutefois des premiers projets de conquête et dès lors, de récits historiographiques soulignant les différences entre « nous » et « les autres ». Citons par exemple Jean de Léry, pasteur huguenot, qui passe plusieurs mois avec les Tupinambas de la baie de Rio en 1577. Il assiste à une cérémonie religieuse, synonyme pour lui de bestialité et de folie : il faut donc les évangéliser.
Au XVIᵉ siècle déjà, les récits occidentaux se distinguent de ceux des empires eurasiatiques : les uns affichent des ambitions de conquête et d’exclusion tandis que les autres avancent des ambitions cosmopolites. En Inde, les empereurs moghols cherchent à concilier traditions hindoues et islamiques dans un seul et même Empire. Il en va de même en Chine, lorsque les Mandchous (Mongols), après leurs victoires contre les Ming, associent les élites militaires et commerciales de ces derniers à la gestion du pouvoir. L’écriture de l’histoire globale s’exprime selon les modalités des constructions impériales. Les Lumières accentuent ces dynamiques avec un regard nouveau : il est désormais moins question d’une pluralité des mondes que de visions universalistes dans le cadre de projets civilisationnistes : l’Europe définit l’homme moderne et cherche à l’imposer au reste du monde. L’homme est soit associé au chrétien, comme dans les écrits de certains pères missionnaires, soit, de plus en plus, à l’animalité. C’est ainsi que s’impose l’idée selon laquelle les Africains méritent d’être mis en esclavage car ils ne sont pas des êtres humains à proprement parler.
Les Lumières, en Europe et ailleurs
Les Lumières s’interrogent sur le bien-fondé des entreprises impériales, sur l’esclavage et, dans le cadre d’une pensée anthropologique et philosophique globale, sur ce qu’est un homme. Des débats semblables ont lieu également en Chine, en Inde et dans l’Empire ottoman ; des histoires philosophiques et des approches anthropologiques y voient le jour.

Une évolution semblable a lieu dans l’Empire ottoman où des discussions tout aussi importantes ont lieu sur l’esclavage, sa compatibilité avec le Coran et sur la légitimité du pouvoir politique. L’Europe n’a pas le monopole des Lumières ; cependant, les attentes et les projets ne sont pas les mêmes, à l’intérieur de l’Europe et encore plus entre cette dernière et les autres régions du monde. Les Lumières européennes ne cherchent pas seulement à éduquer dans leur propre pays, elles s’efforcent d’universaliser leurs valeurs.
Ces tensions entre universalismes européocentriques et histoires nationalistes donnent vie à des contradictions importantes, montant en puissance à partir des années 1870 et encore plus avec la Première Guerre mondiale. Les valeurs européennes se veulent universelles mais leur socle fortement nationaliste produit un double résultat : en Europe même, la décadence des Empires ottoman, russe et autrichien s’accompagne de tensions grandissantes entre grandes puissances – Grande-Bretagne, France, Prusse – mais encourage également le nationalisme à l’intérieur de chaque Empire. Ces tensions se reproduisent dans les Empires coloniaux où une première vague nationaliste voit le jour avant la Première Guerre.
La fin des anciens régimes et empires en Europe accompagne la montée des nationalismes radicaux. Dans l’entre-deux-guerres, l’histoire en général et l’histoire globale en particulier expriment la faillite à penser la globalité hors des cadres nationaux : un avertissement important pour nos débats actuels.
Décolonisation, guerre froide et État social dominent le panorama politique de l’après-guerre ; les empires coloniaux s’effondrent sur fond de guerre froide. L’histoire du « sous-développement » accompagne celle des systèmes-mondes de Braudel et Wallerstein. Pourtant, même si elles se veulent globales, ces approches gardent un cadre conceptuel profondément européocentrique. C’est là le legs le plus important, avec la dépendance économique, du colonialisme.
Montée des nationalismes
La fin de la décolonisation, à partir des années 1970, et encore plus la chute du mur après 1989, ont ouvert les portes à la globalisation actuelle dont l’histoire globale constitue le reflet. Le succès du capitalisme, tant célébré après 1989, a conduit à un résultat paradoxal : l’Occident aura gagné la guerre froide et perdu la paix, comme les crises spéculatives et politiques de ces dernières décennies en témoignent.
C’est à partir du monde actuel et de son histoire que nous pouvons imaginer des solutions différentes ; les polémiques récentes en France sur l’importance de l’histoire nationale dans les programmes politiques et à l’école en témoignent. La manière de penser l’histoire, notamment dans ses dimensions politiques et dans ses échelles – régionale, nationale, coloniale, globale, internationale – constitue un outil formidable pour réfléchir à la manière dont nous souhaitons former nos enfants. La pensée globale décloisonne l’éventail de possibilités qui s’offrent à nous.
Alessandro Stanziani
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.